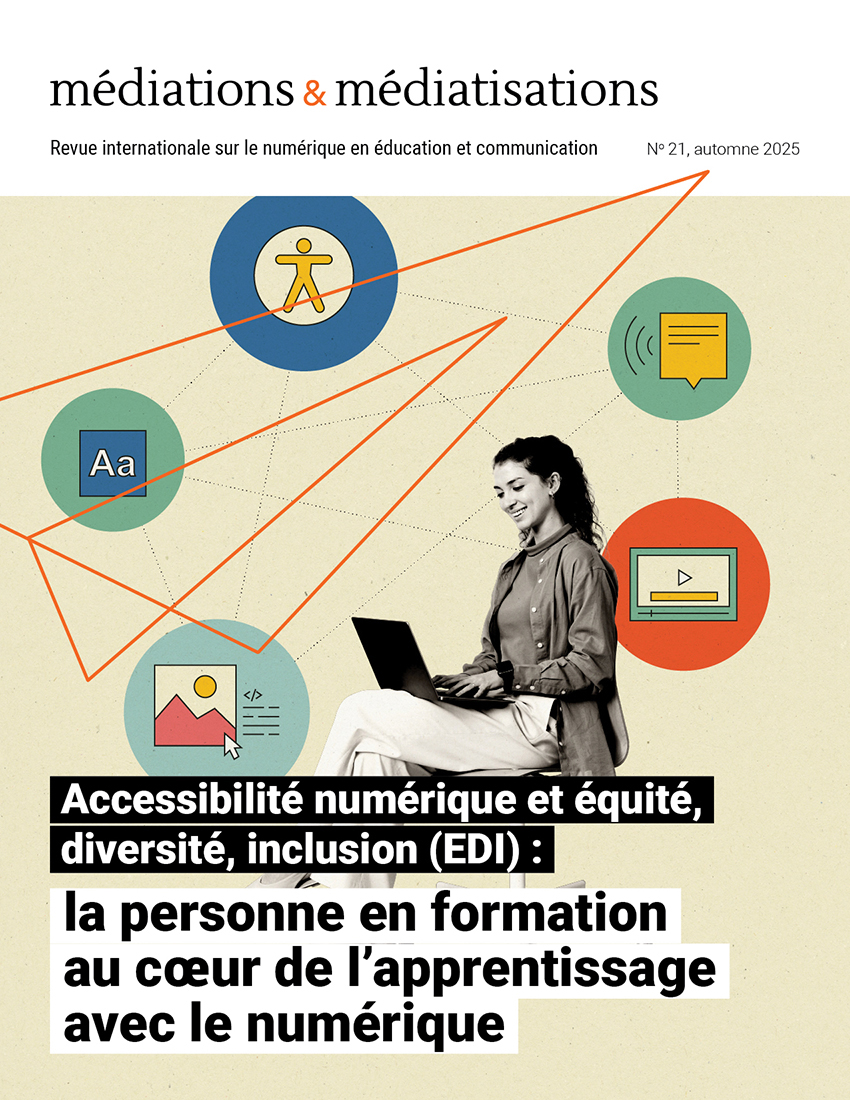Numéro 21, octobre 2025
Accessibilité numérique et équité, diversité, inclusion (EDI) : la personne en formation au cœur de l’apprentissage avec le numérique
DOI: https://doi.org/10.52358/mm.vi21
Publié-e: 2025-10-24
Numéro complet
Sommaire
Éditorial
Résumé
Ce numéro met en lumière les enjeux liés à l’accessibilité numérique et à l’équité, diversité et inclusion (EDI) dans les contextes éducatifs. Il souligne la nécessité d’adapter les formations aux profils variés des personnes apprenantes, qu’elles soient en formation initiale, continue ou en milieu organisationnel. L’accent est mis sur l’importance de dispositifs pédagogiques innovants et flexibles, intégrant le numérique afin de favoriser l’engagement, la motivation et la persévérance. La mise en œuvre de pratiques inclusives requiert de nouvelles compétences professionnelles pour les personnels éducatifs et institutionnels, ce qui soulève aussi des questions liées au bien-être au travail et à la gouvernance. Ce numéro thématique rassemble dix articles de recherche, cinq contributions de praticiens et un débat critique. Les recherches couvrent des contextes variés (écoles, universités, structures éducatives, approches nationales et internationales), explorent des méthodologies diversifiées et analysent les tensions entre inclusion des apprenants et accompagnement des personnels. Les articles de praticiens apportent des perspectives expérientielles issues du terrain, mettant en avant des stratégies concrètes et parfois improvisées pour rendre l’éducation plus inclusive. Enfin, la section débat interroge les angles morts de la recherche sur l’EDI et l’accessibilité, invitant à dépasser les évidences. Globalement, ce numéro offre un cadre multidisciplinaire pour réfléchir aux défis éducatifs du 21e siècle.
Articles de recherche
Résumé
Cet article analyse les effets des Transformations pédagogiques et numériques (TPN) sur les pratiques et la professionnalisation des enseignants-chercheurs (EC), à partir d’un projet d’accessibilisation numérique financé dans le cadre d’une initiative gouvernementale. L’étude, fondée sur une approche compréhensive et une analyse thématique de récits d’expérience de quatre EC, éclaire les (trans)formations (Josso, 2011) générées par cette démarche (trans)formatrice. Elle mobilise la théorie de l’autodétermination (Deci et al., 2017) ainsi qu’une conception du métier articulant dimensions personnelle, impersonnelle, transpersonnelle et interpersonnelle (Miossec et Clot, 2011). Les résultats mettent en évidence des évolutions pédagogiques concrètes : scénarisation, explicitation des contenus, hybridation et attention accrue à l’accessibilité numérique. Le projet satisfait les besoins d’autonomie et de compétence, mais répond de façon ambivalente au besoin d’appartenance. Malgré un fort engagement individuel, la reconnaissance institutionnelle demeure faible, les soutiens collectifs rares et les tensions organisationnelles importantes. Ces limites freinent l’essaimage des innovations et fragilisent l’ancrage d’une motivation intrinsèque durable. L’article plaide pour une approche systémique de la professionnalisation des EC, intégrant toutes les dimensions du métier dans une vision holistique. Il souligne la nécessité d’une reconnaissance structurelle de l’accessibilisation numérique des enseignements (ANDE) comme levier de transformation de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Différencier les enseignements avec et par le numérique ou l’équité à l’épreuve des contraintes
p. 40-57
Résumé
Cet article porte sur l’utilisation du numérique en contexte scolaire au regard des principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), à travers la mise en œuvre de la différenciation pédagogique, et interroge dans quelle mesure il est nécessaire de prendre en compte les apports et les effets du numérique pour enseigner. Cette recherche étudie les pratiques enseignantes en la matière, notamment dans le cadre de la différenciation de supports de cours numériques. La revue de littérature expose la place prépondérante de la diversité en éducation, l’impérieuse nécessité de sa prise en compte, et l’impact de la pratique de l’enseignant permettant d’assurer un certain degré d’équité, notamment à travers la mise en œuvre d’une différenciation pédagogique. Les liens sont tissés avec le numérique, en présentant notamment certaines de ses spécificités et limites, les inégalités qu’il peut creuser qui imposent le recours aux modèles théoriques idoines, et la prise en compte des profils des apprenants. Nous nous intéresserons également au support de cours, vecteur majeur des enseignements, et aux conditions qu’impose le format numérique à l’élaboration de supports utilisables et efficaces qui n’introduisent pas d’obstacles supplémentaires aux apprentissages. Nous dégagerons les tendances des pratiques en cours au moment de l’étude et identifierons les obstacles à leur approfondissement. Nous mettrons également en lumière la complexité de la différenciation de supports numériques de cours et les freins à sa mise en œuvre.
Résumé
Face à la numérisation croissante des universités et à l’entremêlement de leurs sphères de vies, les personnes étudiantes investissent une variété de technologies numériques sans que leurs usages et effets soient pleinement compris. D’apparence neutre, la numérisation et l’entremêlement de ces réalités sociotechniques impliquent un ensemble de rapports de force plus ou moins tacites et d’efforts afférents pour structurer l’ensemble de leur dispositif sociotechnique. Une recherche ethnographique longitudinale explorant les gestions et usages étudiants des technologies numériques a permis de faire émerger une typologie de tensions sociotechniques constitutives de cet entremêlement technologique de leurs réalités et contraintes. En se questionnant sur le labeur numérique comme source potentielle de discrimination indirecte, l’article vise à rendre visible et décrire les rapports de force vécus par les personnes participantes. En problématisant cet angle mort de la numérisation des universités au regard des réalités étudiantes, nous étayerons l’approche sociocritique adoptée, expliciterons le recours à la méthodologie de la théorisation enracinée et le profil des personnes interrogées. Les résultats proposeront une typologie de l’ensemble des tensions liées à la négociation du dispositif sociotechnique, et la discussion terminera avec une réflexion sur les discriminations systémiques indirectes que sous-tend ce labeur numérique tacite des personnes étudiantes contemporaines.
Résumé
Faire face à la diversification croissante des profils étudiants demande aux établissements d’enseignement supérieur d’offrir un continuum de soutiens leur permettant d’être accessibles au plus grand nombre tout en étant adaptés à chacun (Ebersold, 2024). En pratique, ce continuum dépend de l’articulation de trois conceptions distinctes de l’accessibilité, qui font de celle-ci un enjeu pour l’ensemble de la communauté universitaire. Une conception universelle de l’accessibilité prend les plus vulnérables pour référence et fait de l’adaptation de l’université à la diversité des profils étudiants le moyen de prévenir tout besoin d’aide ultérieur. Une conception intégrée prend en compte les inégalités de situation des étudiants en permettant aux personnels d’offrir un soutien susceptible de prévenir toute rupture d’égalité sans remettre en cause le contenu des enseignements. Une conception expresse modifie l’environnement universitaire au coup par coup au regard des difficultés susceptibles d’être induites par un problème de santé. Cet article complète les recherches menées préalablement (Ebersold, 2012, 2017) par des données recueillies auprès de personnels universitaires et d’étudiants présentant un trouble du spectre autistique dans le cadre du projet Atypie Friendly.
Résumé
Les malentendus entre école et numérique trouvent leur origine dans une combinaison de facteurs, certains concrets et d’autres de l’ordre des croyances. D’une part, l’insuffisance de moyens, ou l’absence de formation initiale et continue constituent des obstacles facilement observables et objectivables. Ces constats, appuyés par diverses études, montrent qu’en dépit des nombreuses initiatives gouvernementales, l’intégration des technologies éducatives reste imparfaite à l’école. D’autre part, des représentations concernant le numérique éducatif renforcent ces difficultés. Ces perceptions doivent être analysées sous l’angle du genre, car le corps enseignant, majoritairement féminin, contraste fortement avec les métiers du numérique où les femmes ne représentent qu’environ 17 %. La crise de COVID-19 en 2020 a contraint le corps enseignant à utiliser le numérique en urgence, sans formation ni ressources, bouleversant les représentations. Le but de cet article est de voir ce qui reste des représentations genrées du numérique. Deux corpus – 1054 questionnaires et 24 entretiens semi-directifs – permettent d’étudier l’évolution de ce rapport avant et après la pandémie. Si on constate dans les questionnaires que les femmes ont un rapport au numérique plus serein après la pandémie, elles peinent dans les entretiens à se déclarer compétentes, contrairement aux hommes, et malgré des pratiques avérées.
Résumé
L’utilisation des jeux vidéo d’action (JVA) peut apporter des bénéfices significatifs aux élèves dyslexiques en améliorant leur concentration et leur vitesse de lecture. De plus, l’ajout d’une méthode éprouvée en rééducation et personnalisée à l’apprenant augmente l’efficacité du transfert de compétence en lecture. Nous avons développé un jeu vidéo d’action sérieux (JVAS) visant à accroître les compétences des participants tout en maintenant leur motivation. Notre artefact est évalué sur quatre critères clés : la vitesse de lecture, la réduction des erreurs, le niveau d’attention et la motivation. Notre protocole expérimental, fondé sur une étude de cas multiple, intègre des données qualitatives et quantitatives, révélant une amélioration notable des compétences en lecture des sujets. Le maintien de la motivation reste difficile.
Résumé
Cet article explore comment le rapport au numérique de l’étudiant influence ses pratiques d'apprentissage dans des environnements hybrides en s'inscrivant dans une démarche intégrant les principes d'équité, de diversité et d'inclusion. S'appuyant sur une épistémologie didactique clinique, l'étude examine deux cas contrastés d'apprenantes inscrites dans un master hybride disposant d’un outil innovant : le Générateur d'Espace Privé de Travail (GÉNeSPRIT). Cet outil fusionne les environnements d'apprentissage institutionnels et personnels, en mettant l'accent sur une approche centrée sur le sujet apprenant. À travers une méthodologie en trois étapes : le déjà-là, l’épreuve et l'après-coup, la recherche met en lumière les tensions entre inclusion, flexibilité et maîtrise technologique. Tandis qu’une étudiante exploite les outils numériques pour optimiser son apprentissage, l’autre rencontre des obstacles liés à une méconnaissance des outils, amplifiant son sentiment d'isolement. Les résultats suggèrent des pistes heuristiques pour créer des environnements d'apprentissage plus adaptatifs et inclusifs, en proposant des leviers didactiques et technologiques pour renforcer l'accessibilité et l'engagement des apprenants en formation à distance.
Résumé
Dans le cadre de la nécessaire mise en accessibilité des espaces et des contenus pédagogiques, nous commencerons par étudier les textes législatifs français afin d’identifier certaines injonctions contradictoires qui y résident. Puis, nous nous questionnerons sur les potentialités offertes à la communauté des apprenants par les outils numériques dans le cadre de la conception universelle des apprentissages. Nous nous demanderons si ces outils sont identifiés par les enseignants comme des ressources permettant d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap. L’adhésion des professionnels étant un prérequis essentiel au déploiement de ces pratiques, nous nous interrogerons également sur leur réception de l’idée de l’accessibilité pédagogique à visée universelle. L’étude d’un corpus produit par les réponses de 516 professionnels de l’éducation à une enquête nous permettra d’établir que le paradigme intégratif et l’idée d’une nécessaire réponse basée sur une catégorisation (effectuée sur des critères médicaux) à la question de savoir comment scolariser les élèves en situation de handicap représente des obstacles majeurs au déploiement des pratiques d’accessibilisation pédagogique, notamment par le numérique.
Résumé
L’intégration des technologies immersives et hybrides dans l’enseignement du design redéfinit les paradigmes pédagogiques en introduisant des environnements interactifs favorisant une compréhension plus intuitive des concepts complexes. La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) offrent de nouvelles modalités d’apprentissage, mais leur adoption soulève des défis d’accessibilité et d’inclusion, interrogeant les principes d’équité éducative. L’accessibilité numérique ne se limite pas à une question technique; elle exige une approche inclusive prenant en compte les diversités cognitives, sensorielles et culturelles des apprenants. L’étude explore l’impact de ces technologies sur l’apprentissage du design, en posant l’hypothèse qu’une intégration réfléchie, combinée à des stratégies pédagogiques inclusives, pourrait améliorer l’efficacité éducative et démocratiser l’accès à la formation. Une méthodologie mixte a été adoptée, associant une enquête quantitative menée auprès de 65 enseignants et 120 étudiants issus d’établissements européens et tunisiens de design, ainsi que des entretiens qualitatifs pour identifier les freins et les leviers d’adaptation. Les résultats mettent en évidence des disparités dans l’adoption de ces outils, soulignant la nécessité d’une vigilance méthodologique et éthique pour assurer une appropriation équitable des innovations technopédagogiques et garantir un apprentissage accessible, durable et inclusif.
Résumé
L’intégration du numérique dans l’enseignement secondaire est désormais incontournable. Toutefois, tous les élèves ne disposent pas du même accès aux technologies ni des mêmes habiletés numériques ou expériences d’usage, ce qui influence leur capacité à en tirer profit. Cette disparité s’explique, d’une part, par les différences dans l’utilisation des technologies par les enseignants et, d’autre part, à la fois par la diversité des pratiques numériques des personnes enseignantes et par l’hétérogénéité des besoins et préférences des apprenants. Cette recherche vise à mettre en lumière la diversité des besoins et préférences des élèves du secondaire en matière d’usage du numérique, en s’alignant avec les principes de la conception universelle de l’apprentissage (CUA). Plus précisément, cette étude cherche à comprendre et à expliquer quels usages du numérique, adoptés par les personnes enseignantes, favorisent l’apprentissage et l’engagement d’un large éventail d’élèves, en tenant compte de leurs besoins individuels dans une perspective inclusive. Menée selon une approche méthodologique qualitative descriptive, elle se base sur des entrevues individuelles menées avec 17 personnes enseignantes et 40 élèves au secondaire, dans une diversité de niveaux et d’écoles au Québec. Les résultats sont organisés selon les trois grands principes de la CUA, de façon à mettre en relief les pratiques et usages du numérique susceptibles de soutenir les apprentissages et l’engagement d’une variété d’élèves en enseignement secondaire, dans une perspective inclusive.
Articles de praticiens
Résumé
Dans le contexte de l'enseignement supérieur en France, les ingénieurs pédagogiques peuvent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de l'accessibilité numérique, essentielle pour garantir une pédagogie plus inclusive. Cet article examine une opportunité de formation diplômante à l'accessibilité numérique pour ces professionnels. L’article s'appuie sur les parcours de formation de trois ingénieurs pédagogiques qui partagent leurs expériences sur l'acquisition de nouvelles compétences en accessibilité numérique et les perspectives offertes par ces nouvelles compétences. Leurs témoignages illustrent comment cette formation a influencé leur évolution professionnelle, en élargissant leurs missions actuelles ou en facilitant les transitions vers de nouvelles missions. En outre, l'article explore les tensions entre les injonctions institutionnelles, légales, les enjeux pédagogiques et la nécessité pour ces professionnels de s'adapter à un métier en constante évolution. Positionnés au carrefour de multiples acteurs, ils doivent naviguer à travers les transformations technologiques et les nouvelles pratiques pédagogiques induites par le numérique. Il tente de mettre en lumière les défis et opportunités liés à la formation à l’accessibilité numérique, tout en soulignant l'importance du travail en intermétier pouvant favoriser une pédagogie plus inclusive.
Résumé
Vingt ans après la loi de 2005 sur l’égalité et la citoyenneté des personnes handicapées, cet article analyse l’accessibilité numérique dans l’enseignement supérieur, en particulier pour les étudiants avec des troubles spécifiques du langage. Par l’exemple de l’université d’Orléans, il souligne les progrès, mais aussi les limites d’une accessibilité souvent technocentrée, illustrées par des choix mal orientés. L’article plaide pour une accessibilité raisonnée, centrée sur l’expérience utilisateur, et tenant compte des besoins individuels. Il met en lumière les tensions entre l’accessibilité généralisée et l’inclusion ciblée, appelant à une complémentarité entre la compensation individuelle et les adaptations collectives. La réconciliation passe par une éducation à l’inclusion pour tous les acteurs universitaires, évitant l’invisibilisation des profils spécifiques et garantissant une accessibilité équitable, fondée sur des bases scientifiques et une médiation humaine.
EDI, l’apport caché des chaines éditoriales
p. 241-250
Résumé
La prise en compte de l’équité, diversité et inclusion (EDI) dans les enseignements universitaires est souvent abordée sous deux angles distincts : d’un côté l’accessibilité numérique des supports et de l’autre la transformation des pratiques pédagogiques. Cet article aborde comment l’utilisation d’une chaine éditoriale dans la réalisation de la ressource entraine une révision pédagogique du support et une démarche réflexive sur la mise en accessibilité d’un enseignement. Sous le terme de chaine éditoriale sont regroupés les outils imposant une séparation du fond et de la forme. Les avantages et les freins de ces outils sont rappelés plus précisément pour la solution Scenari utilisée dans cette étude. À partir d’ateliers menés à distance ou en présentiels avec des enseignants de sciences volontaires, mais dans des contextes de production différents, nous examinons les difficultés et les bénéfices de la démarche entreprise qui entraine une amélioration des supports en adéquation avec une meilleure approche inclusive des enseignements.
Résumé
Dans le contexte de l’éducation inclusive, cet article présente la première étape d’une démarche d’exploration du potentiel des outils numériques au service de pratiques pédagogiques inclusives. S'appuyant sur une méthodologie interdisciplinaire type méthode Delphi, il développe un outil d’analyse visant à évaluer la pertinence et les limites des outils numériques en contexte inclusif. En mobilisant l'hétérogénéité comme ressource collective, cette recherche interroge les pratiques éducatives à travers une approche systémique favorisant l’interaction entre les acteurs et l'appropriation progressive des outils par les enseignants.
Vers une évaluation plus inclusive : repenser les pratiques à travers une formation de formateurs
p. 262-273
Résumé
Cette contribution présente une formation de formateurs à l’Institut français de l’Éducation (IFÉ – ENS de Lyon) visant à penser les pratiques évaluatives dans une perspective d’inclusion et d’équité. L’objectif principal de la formation est d’accompagner les formateurs d’enseignants, de la maternelle à l’enseignement supérieur, dans le développement de pratiques évaluatives sommatives plus inclusives en interrogeant les principes d’usage du numérique et de différenciation pédagogique. Les pratiques évaluatives sommatives actuelles confrontent souvent les enseignants à un dilemme professionnel : comment concilier des conceptions traditionnelles de l’évaluation fondées sur l'égalité avec des approches inclusives basées sur l'équité (Yerly et al., 2024)? Alors que le numérique est fréquemment perçu comme une réponse immédiate aux défis d’adaptation des apprentissages, nous choisissons ici de l’aborder dans une perspective inclusive (Benoit et Feuilladieu, 2017). Cette contribution défend une approche qui ne se limite pas au numérique comme outil, mais au numérique comme un outil au service d’une réflexion approfondie sur les objectifs pédagogiques et les obstacles à l’apprentissage. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2019, 2021) et de la conception universelle des apprentissages (CUA) (CAST, 2024), qui favorisent une vision systémique de l’inclusion.
Discussions et débats
Résumé
Généralement, les recherches en lien avec l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), s’intéressent aux personnes handicapées, aux minorités ethniques ou culturelles ainsi qu’aux minorités sexuelles ou de genre. Elles s’inscrivent dans la lignée des actions ayant progressivement permis aux femmes de prendre leur place dans la société en l’élargissant à une plus grande diversité de publics particuliers. Les personnes de sexe masculin ne présentant pas de handicap et ne faisant pas partie d’une minorité constituent ainsi souvent l’impensé de ces études. Pourtant, les données disponibles mettent en évidence que sur le plan de l’enseignement supérieur, ils ne sont plus majoritaires parmi nos étudiants depuis longtemps. Nous verrons ainsi qu’il est nécessaire de regarder ce qu’il se passe en amont des études supérieures, car les retards et abandons scolaires commencent dès l’enfance. Cela peut amener à remettre en question le rôle que pourrait jouer l’intégration de certaines technologies pour soutenir la scolarité des garçons. Par ailleurs, nous verrons que les inégalités de revenus en défaveur des femmes sont également susceptibles d’expliquer une différence de profitabilité de l’enseignement supérieur entre hommes et femmes, ce qui souligne l‘importance de prendre en considération les rapports entre les publics particuliers étudiés et les autres.