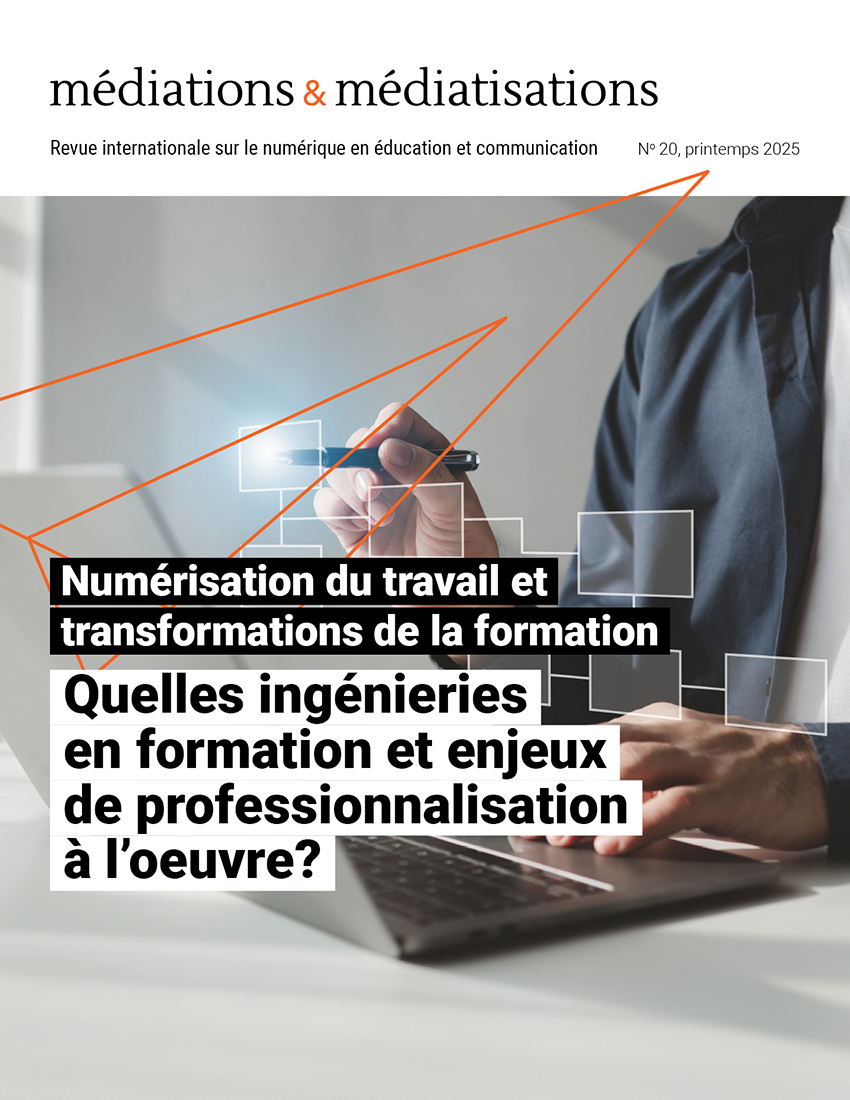Numéro 20, avril 2025
Numérisation du travail et transformations de la formation. Quelles ingénieries en formation et enjeux de professionnalisation à l’œuvre?
DOI: https://doi.org/10.52358/mm.vi20
Publié-e: 2025-04-17
Numéro complet
Sommaire
Éditorial
Résumé
Les progrès technologiques et les changements économiques et politiques ont modifié la manière de travailler (Labbé et Champy-Remoussenard, 2013; Perreau et Wittorski, 2023). Aujourd’hui, ce sont par exemple les questions de la formation tout au long de la vie qui conduisent à observer un transfert progressif vers chaque citoyen de la gestion de son propre parcours de formation et d’emploi. Ajoutons à cela les innovations liées au développement du numérique, mais aussi les nouvelles pratiques associées aux situations instrumentées (simulation, réalité virtuelle ou immersive, dispositifs à distance ou hybrides) et nous aurons un tableau des transformations qui régissent à la fois le monde du travail et de la formation. Pour accompagner cette réflexion et afin de pouvoir répondre aux nouvelles exigences auxquelles il est confronté, le champ de la formation se réinvente en réinterrogeant les ingénieries de formation et pédagogiques qui lui sont nécessaires (Ardouin, 2017; Renier et Guillaumin, 2023; Verquin Savarieau et Papadopoulou, 2023). C’est pourquoi ce sont les savoirs et les pratiques même des métiers de la formation que nous interrogerons, en remettant en question les ingénieries qui constituent le produit négocié d’interactions sociales, politiques, techniques et pédagogiques.
Articles de recherche
Résumé
En contexte d’universitarisation avec double diplomation (diplôme d’État et licence universitaire), des formations paramédicales et de mise en place de l’expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé au sein de l’Université de Caen-Normandie, de nouveaux référentiels (licence sciences du soin) et des maquettes de formations professionnelles sont produits pour six professions paramédicales. Une nouvelle ingénierie pédagogique est à inventer en tenant compte des nouvelles modalités hybrides de la formation. Cet article analyse l’ingénierie de formation mise en place pour la conception collective d’un module de formation consacré au raisonnement clinique. La démarche de création et d’innovation pédagogique entreprise est réalisée à partir des expériences de travail collectif de professionnels. Elle permet d’identifier les invariants de l’activité dans le raisonnement clinique, avec un regard de formateurs, en repérant des classes de situations emblématiques issues des différents terrains professionnels et transférables aux six professions. La séquence produite collaborativement débouche sur la mise en scène d’une situation de travail habituelle des professionnels en activité, répondant à leurs enjeux de formations : la rencontre du patient et l’analyse de ses déficiences et/ou besoins.
Ingénierie d’interface et hybridation des dispositifs : perspectives pour la formation de formateurs
p. 32-53
Résumé
Dans le cadre de dispositifs de formation hybrides et par alternance, l’introduction d’activités de formation à distance fait apparaître un nouvel espace-temps de formation, parfois appelé tiers espace-temps (Papadopoulou, 2020). L’efficacité de ces dispositifs ensembliers, dont les concepteurs cherchent à étayer la cohérence d’ensemble, s’appuie sur la structuration d’un système d’interface. Ce dernier organise les liens entre les différents environnements et situations de formation. Les résultats présentés montrent que si ces systèmes d’interface sont producteurs de reliances entre les mondes professionnel et académique, il reste difficile de les faire vivre lorsqu’un tiers espace numérique intègre les espaces de formation existants. Nous présentons quelques hypothèses pour expliquer cette difficulté à transformer les pratiques, et quelques autres pour remettre en question la manière dont les formateurs conçoivent et animent les ingénieries d’interface. Nous mobilisons, pour ce faire, le cadre des capabilités. Pour terminer, nous élaborerons quelques pistes de travail concernant la formation de formateurs.
Résumé
Les jumeaux numériques d’enseignement (JNE) sont des environnements virtuels pour l’apprentissage humain (EVAH) qui ouvrent des perspectives en matière de conception pédagogique pour se rapprocher des réalités professionnelles des ingénieurs. Le jumeau numérique est la réplique numérique d'un objet ou d'un système industriel ou physique existant, qui peut être doté d’outils d’exploitation pour comprendre, analyser et prédire le fonctionnement et le pilotage de l’entité réelle. Il peut devenir un instrument pour l’enseignement. L’intégration des JNE, en tant que nouvel environnement virtuel d’apprentissage, engage un travail de conception pédagogique visant la création de situations d’apprentissage instrumentées. L’article porte sur ce travail de conception pédagogique mené de manière collaborative entre des ingénieurs pédagogiques, des enseignants-chercheurs et des développeurs informatiques dans le cadre du projet JENII (ANR-21-DMES-0006). Les données de recherche sont issues de 13 entretiens semi-directifs menés auprès des acteurs du projet, de 3 entretiens avec des ingénieurs pédagogiques et de l’observation de 3 réunions de conception de scénarios pédagogiques utilisant des JNE. Les résultats permettent de mieux comprendre la conception collaborative de dispositifs pédagogiques, d’identifier les nouveaux acteurs autour de la technologie émergente des JNE et de mettre en lumière les leviers d’action pour optimiser l’ingénierie pédagogique avec des technologies émergentes.
Résumé
Le numérique induit de nouvelles formes d’activités et transforme les espaces de travail. Les relations qu’entretiennent les salariés s’en trouvent modifiées. Ce constat est d’autant plus prégnant dans les métiers de la relation à autrui. Nous nous sommes intéressés à l’accompagnement professionnel afin de répondre à la question : en quoi le numérique modifie-t-il l'accompagnement fondé sur la relation à autrui? On constate un manque de recherches scientifiques sur ce sujet, en particulier pour aborder la question de la posture des acteurs et des actrices face aux impacts du numérique sur leurs interactions. Notre étude miroir permettra d’interroger des accompagnantes et des bénéficiaires d’un dispositif dans le cadre du bilan de compétences. Nous avons mené des entretiens semi-directifs et nous avons analysé notre corpus en deux temps, grâce à Iramuteq complété par une grille d’entretien. Notre analyse est soutenue par les verbatim des répondantes et répondants. Même si le numérique est intégré dans les pratiques d’accompagnement, l’environnement de travail est rendu moins capacitant dans les relations humaines. Les accompagnantes trouvent des pratiques innovantes pour conserver une forme de proximité et les bénéficiaires adoptent une attitude facilitatrice.
La sociologie de la formation à l'ère numérique : nouvelles ingénieries et professionnalisation
p. 95-121
Résumé
Cette étude vise à analyser comment la digitalisation du travail et les innovations technologiques influencent les ingénieries de formation et les processus de professionnalisation dans le cadre du diplôme de licence en sociologie. Une méthodologie qualitative basée sur l'analyse du discours sociotechnique (ADS) a été utilisée pour examiner la relation entre la technologie et la société, et comment ces dynamiques affectent la formation universitaire en sociologie. Les principaux résultats révèlent une résistance institutionnelle importante à l'adoption des technologies numériques (TD) et aux changements curriculaires, ainsi qu'une perception de la digitalisation comme une solution temporaire. Des barrières telles que la gérontocratie, l’insuffisance d'infrastructure technologique et un système d'incitations qui décourage la collaboration ont été identifiées. Les conclusions soulignent la nécessité urgente de moderniser le curriculum en sociologie pour inclure des compétences numériques avancées et promouvoir une culture d’innovation. Il est recommandé de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques incluant l’utilisation transversale des technologies numériques émergentes, des programmes de formation continue pour les enseignants et une réforme curriculaire intégrale.
Résumé
Cette recherche examine la transition des pratiques d’ingénierie pédagogique dans la fonction publique québécoise visant à modéliser des pratiques optimales pour favoriser leur mise en œuvre et leur pérennisation dans un contexte post-pandémique. À l’aide d’une approche méthodologique qualitative, nous avons mené des entretiens semi-structurés auprès de 12 professionnels issus de 10 organismes publics, sélectionnés pour leur rôle actif dans le développement de formations. Les résultats indiquent que l’adaptation des formations aux besoins des participants et la consolidation des pratiques pédagogiques sont essentielles pour assurer l’efficacité de l’apprentissage à distance. Bien que des avancées aient été réalisées dans l’utilisation des technologies et la formation des formateurs, des défis demeurent concernant la qualité, la cohérence des contenus et la formalisation des processus de conception. À l’avenir, l’établissement d’une gouvernance collaborative et une intégration plus efficace des outils technologiques s’avèrent cruciaux pour garantir des formations durables et adaptées à un environnement en constante évolution.
Articles de praticiens
Résumé
En France, les INSPÉ (Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’Éducation) forment les étudiants aux métiers du professorat, de l’éducation et de la formation. Face à la crise qui touche le recrutement et la formation des enseignants (Devos et Paquay, 2013; Dubet, 2020), l’INSPÉ de l’académie de Bordeaux, en collaboration avec les INSPÉ des académies de Poitiers et de Limoges, expérimente depuis plusieurs mois un dispositif de création de ressources pédagogiques sous forme de vidéos 360°, dans l’objectif de proposer aux futurs enseignants des apprentissages expérientiels, incarnés et situés. Cet article s’appuie sur une étude de cas portant sur la mise en œuvre du dispositif dans la formation des futurs enseignants documentalistes. Il explore les étapes clés, de la conception des contenus à la diffusion des ressources pédagogiques, en passant par la captation immersive à 360° en environnement professionnel. En plus d’analyser les premiers résultats, les potentialités et les limites de ce dispositif, l’article ouvre des pistes de réflexion sur l’impact de la technologie de vidéo 360° sur le plan de l’engagement cognitif, émotionnel et corporel des étudiants, ainsi que sur les dynamiques collaboratives générées par une approche pédagogique innovante.
Résumé
Cet article aborde l’évolution des métiers de la formation en lien avec les technologies émergentes en s’intéressant plus particulièrement à l’adaptation de la professionnalisation des ingénieurs pédagogiques et formateurs d’adultes depuis 2019. Il souligne comment les changements économiques et politiques ont modifié rapidement leur travail, obligeant les entreprises dans un environnement concurrentiel à faire évoluer les compétences numériques des formateurs en poste et celles des étudiants en cours de diplomation à l’université. À l’appui d’un modèle d’ingénierie multimodale intégrant des pratiques pédagogiques variées, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, le texte présente la stratégie d’action et la résolution de problèmes mises en place dans un parcours de master en France pour gérer cette course en avant tout en renforçant la qualité des usages numériques et demeurer en cohérence avec les compétences au cœur des métiers de l’interaction avec autrui auxquels se destinent les étudiants.
Discussions et débats
Résumé
Le travail dans le champ de la formation des enseignants se numérise et l’accès facilité aux intelligences artificielles génératives ouvrent de nouveaux possibles. Les transformations induites sont analysées en se référant à la situation d’un établissement qui s’est engagé dans un projet visant à inscrire la formation continue des enseignants dans une perspective de Lifelong learning. Cette contribution montre l’utilité de problématiser les transformations induites par l’activité technique en recourant à une approche stieglérienne. Cette problématisation nous pousse à prendre en compte le développement tant sur le plan des individus (cette approche met en garde contre l’abrutissement de l’individu), des collectifs (cette approche met en évidence le risque d’individualisme lorsque la technique isole les individus et court-circuite ou contraint les processus de délibération collective) et des techniques (cette approche permet de penser l’appropriation des techniques par les individus et les collectifs pour qu’ils puissent rester capables de participer à la définition de l’environnement qui structure leurs pratiques). À partir d’un cas portant sur une formation de master, cette contribution met en évidence comment cette problématisation permet d’orienter la conception de situations de formation dans une perspective de Lifelong learning.